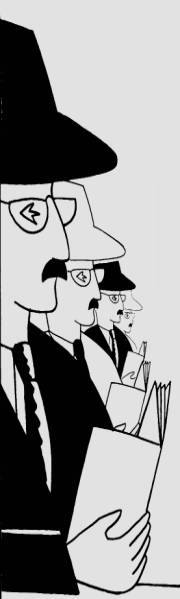 Rares sont les écrivains qui ont su exprimer avec justesse l’étendue de leur personnalité et par-là même les contradictions qui régissent tout être humain. FERNANDO PESSOA, grand nom de la littérature portugaise fait partie de ceux-là. Secrétaire à la correspondance étrangère pour diverses sociétés de commerce, il mena une vie esseulée, partagée entre une vie professionnelle étriquée et un univers intérieur cultivé par l’écriture.
Ses passions, ainsi que son activité culturelle et littéraire sont pourtant d’une diversité étonnante: il crée une imprimerie qui fera banqueroute ; fonde avec son meilleur ami une revue de comptabilité et de commerce qui ne durera qu’un temps, envisage même la création d’un cabinet d’astrologie. Il fonde plusieurs écoles comme le « paulisme », l’ « intersectionnisme », le « sensationnisme », autant de pensées exaltant une intelligence et une sensibilité nouvelle rappelant le futurisme engendré par l’écrivain Marinetti. Il publie plusieurs essais critiques dans la revue « Orphée » où son désir ardent de transcender la culture portugaise, jusqu'à affirmer une nouvelle renaissance, s’affiche avec férocité : « Nous ne sommes pas des portugais qui écrivent pour des portugais, cela nous le laissons aux journalistes et aux éditoriaux politiques. Nous sommes des portugais qui écrivent pour l’Europe, pour toute la civilisation ». Ce fut à sa mort que l’on découvrit une malle remplie de poèmes et de proses ; mais aussi de divers textes en anglais.
Rares sont les écrivains qui ont su exprimer avec justesse l’étendue de leur personnalité et par-là même les contradictions qui régissent tout être humain. FERNANDO PESSOA, grand nom de la littérature portugaise fait partie de ceux-là. Secrétaire à la correspondance étrangère pour diverses sociétés de commerce, il mena une vie esseulée, partagée entre une vie professionnelle étriquée et un univers intérieur cultivé par l’écriture.
Ses passions, ainsi que son activité culturelle et littéraire sont pourtant d’une diversité étonnante: il crée une imprimerie qui fera banqueroute ; fonde avec son meilleur ami une revue de comptabilité et de commerce qui ne durera qu’un temps, envisage même la création d’un cabinet d’astrologie. Il fonde plusieurs écoles comme le « paulisme », l’ « intersectionnisme », le « sensationnisme », autant de pensées exaltant une intelligence et une sensibilité nouvelle rappelant le futurisme engendré par l’écrivain Marinetti. Il publie plusieurs essais critiques dans la revue « Orphée » où son désir ardent de transcender la culture portugaise, jusqu'à affirmer une nouvelle renaissance, s’affiche avec férocité : « Nous ne sommes pas des portugais qui écrivent pour des portugais, cela nous le laissons aux journalistes et aux éditoriaux politiques. Nous sommes des portugais qui écrivent pour l’Europe, pour toute la civilisation ». Ce fut à sa mort que l’on découvrit une malle remplie de poèmes et de proses ; mais aussi de divers textes en anglais.
PESSOA écrivait sous plusieurs hétéronymes représentant ses différents moi rêvés ou partiellement existants, une particularité qu’il cultivait depuis l’enfance comme en témoigne un vieux poème dédié à sa mère où il s’inventait le double de « chevalier de pas ». Ses hétéronymes les plus célèbres sont Alberto CAIRO, poète dit matérialiste, réceptif à la réalité de toute chose et résolument opposé aux spéculations des poètes classiques : « Je crois au monde comme à une pâquerette, parce que je le vois. Mais je ne pense pas à lui parce que penser c’est ne pas comprendre » - « Ah ! , comme les simples hommes sont malades et stupides et confus auprès de la claire simplicité et de la toute saine existence des arbres et des plantes ». Son disciple, Ricardo REIS, est un adversaire du modernisme qui l’étouffe. Influencé par le paganisme (croyance aux dieux de l’antiquité grecque), il cherche à calmer son angoisse par la voie des plaisirs, l’amour de la nature et de la vie ; contrairement au sto ïcisme et à l’assurance implacable de son maître, la démarche poétique de REIS part d’une volonté de croire en l’aspect inéluctable de la vie.
Alvaro DE CAMPOS est un personnage ouvert à la multiplicité de la vie, voyageant sans cesse, engloutissant l’univers au sein de son être : « j’aime tout, j’anime tout, à tout je confère l’humanité, aux hommes et aux pierres, aux âmes et aux machines, pour accroître d’autant ma personnalité », une philosophie panthéiste qui le plonge parfois dans le sentiment douloureux d’avoir vu défiler le monde sans en avoir saisi la substance ; le pauvre Alvaro de Campos se retrouvant dénué de toute paix intérieure, en proie à une faim insatiable. « Le livre de l’intranquillité » est l’œuvre la plus troublante de l’écrivain ; écrite sous forme d’un journal fictif, on y découvre Bernardo SOARES, l’hétéronyme le plus proche de ce que fût Fernando Pessoa ; expérimentant le sentiment du non-être, de l’inutilité de toute chose, de l’impossibilité de se frayer un chemin dans l’humanité. L’ennui lui pèse et sa seule alternative est d’inventer sa vie par le biais de l’imagination jusqu'à voir dans le rêve une réalité plus concrète que la réalité même : « Il est des figures du temps passé, des images esprits contenues dans les livres, qui sont pour nous plus réelles que ces indifférences incarnées qui nous parlent par-dessus le comptoir, ou nous regardent par hasard dans le tram… ».
Beaucoup de critiques littéraires se sont penchés sur le mystère PESSOA par cette interrogation évidente : Qui était- il ? Lorsque l’on sait que PESSOA veut dire « personne » en portugais, ce mystère n’en devient que plus grand. Peut être était- il un personnage d’une pudeur extrême, mu par une sensibilité qu’il s’interdisait de communiquer par peur de devoir se justifier, de se laisser contaminer par une incompréhension ou une reconnaissance dont il n’avait pas besoin, déléguant à ses hétéronymes le soin de vivre ses sentiments riches et contradictoires. Lui seul aurait pu nous le dire.
Le centre d’étude Fernando PESSOA continue de défricher son œuvre immense, découvrant encore de nouveaux hétéronymes, d’autres facettes d’un personnage qui, s’il était encore vivant, n’en continuerai pas moins de se multiplier jusqu’au paroxysme.
HERVE